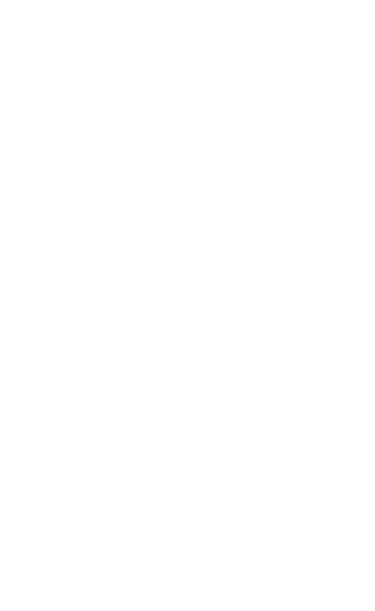Cartographier pour mieux protéger : quand les communautés locales tracent leur avenir
Comprendre l’utilisation des terres est essentiel tant pour la conservation que pour le contribuer au développement des communautés locales. Dans le Parc National de Conkouati-Douli, un projet de cartographie participative permet aux populations locales de délimiter leurs territoires, de documenter leurs droits ancestraux et de contribuer à une meilleure gestion du parc. Ce travail de fond est un préalable indispensable pour accompagner les communautés dans l’élaboration future de leur plan de développement local et d’aménagement du terroir, outil clé pour encourager les villages à être acteurs de leur propre développement. Portée par l’unité de gestion du parc, cette initiative de cartographie participative s’étend sur 31 villages et allie savoirs traditionnels, outils modernes de cartographie et collaboration communautaire. En impliquant activement les habitants, le projet vise à améliorer la résolution des conflits, à renforcer la conservation et à garantir que ceux qui vivent sur ces terres depuis des générations aient leur mot à dire sur leur avenir. Dans cette interview, nous explorons le fonctionnement de la cartographie participative, son importance et son impact sur la conservation d’un des écosystèmes les plus riches d’Afrique Centrale.
English version below


Pouvez-vous nous présenter brièvement le projet de cartographie participative dans le Parc National de Conkouati-Douli ?
La cartographie participative est un outil qui permet aux communautés locales de représenter leur espace de vie traditionnel sur une carte. Cette démarche contribue à une meilleure compréhension de l'utilisation des territoires villageois et à la reconnaissance des droits coutumiers des habitants. Initiée par l'Unité de Gestion du Parc National de Conkouati-Douli, cette initiative concerne 31 villages et s'étend de juin 2023 à décembre 2024.
Quels sont les principaux objectifs de ce projet ?
Les objectifs sont multiples. D’abord, de développer une base de données cartographique précise sur l’utilisation villageoise de la forêt. Ensuite, de contribuer à une meilleure compréhension du conflit homme-faune autour du Parc, de la fréquence et de la localisation de ces conflits. Par ailleurs, l’outil permet de doter les communautés d’un support physique (une carte) justifiant leur terroir ou zone d’action tout en représentant leurs droits ancestraux. Il permet aussi de s’assurer que les communautés ont les capacités et la connaissance nécessaire pour comprendre les enjeux de la démarche et pour produire leurs propres cartes, dans le cadre de l’élaboration de leur plan de développement local.
Enfin, cela permet d’aider les différentes parties prenantes (Parc national et populations riveraines) à comprendre l’utilisation du terroir villageois, encourager la conservation de la forêt et de la faune en impliquant les communautés, et orienter les décisions dans la révision du plan du plan d’aménagement du Parc.
Pourquoi est-il essentiel d'impliquer les communautés locales ?
Les communautés sont les usagers permanents de ces territoires. Leur participation est essentielle car elles possèdent une connaissance approfondie des zones d’usage traditionnel, des sites sacrés et des espaces de vie de la faune. Cette collaboration permet aussi d'identifier des problèmes invisibles, comme les inégalités sociales ou les conflits d'usage.
Comment se déroule concrètement une séance de cartographie participative ?
Le processus comprend plusieurs étapes :
La sensibilisation : une activité qui permet de sensibiliser les communautés sur le processus de cartographie participative. Elle permet également d’obtenir le consentement éclairé et implication volontaire des communautés avec signature d’un procès-verbal ;
Collecte des données socio-économiques : après l’obtention du consentement éclairé et implication volontaire, des focus groupes sont organisés avec les différentes couches sociales du village (autochtone, homme, femme). Il s’agit de réunions permettant de collecter des données sur les caractéristiques générales du village, la situation socio-économique des communautés, la gestion de leurs ressources naturelles et la perception qu’elles ont face aux conflits hommes faunes ;
Elaboration de la carte au sol : après collecte des données socio-économiques, les communautés représentent au sol leur terroir (en utilisant une maquette interactive). L’équipe du développement communautaire facilite cette activité. Par la suite une reproduction sera faite sur du papier dure.
Collecte de donnée GPS et élaboration des cartes : après la sensibilisation, l’équipe accompagne les communautés (qui reçoivent en amont une formation sur l’utilisation du GPS) sur le terrain pour identifier et prendre les points GPS des différents éléments inscrits sur la carte au sol. Cette phase est appelée phase de vérité terrain, elle permet de géolocaliser les zones et sites des activités d’usage communautaire. A l’issu de cette mission de terrain, les données collectées sont représentées sur une carte géo-référenciée.
La validation et restitution des cartes : la validation des cartes passe par une concertation des communautés autour de la carte pour vérifier les différents éléments placés sur la carte. Pendant la phase de validation, l’équipe s’assure que les communautés sont en mesure de lire et d’interpréter leur carte participative, au besoin un renforcement de capacité est fait. Cette dernière étape est donc le point essentiel et plus important du processus car c’est la dernière étape qui dote la communauté de la carte de leur terroir.
Quelles informations sont intégrées dans la carte finale ?
Les cartes finales contiennent des données géographiques (coordonnées GPS des zones identifiées), des zones d’usage, des informations socio-économiques et historiques des villages. Elles sont produites à l'aide de logiciels de système d'information géographique (SIG).
Comment les communautés ont-elles réagi face à ce projet ?
La majorité des villages ont accueilli le projet avec enthousiasme. Toutefois, certaines communautés (Mpella, Tandou-Goma, Nzambi, Cotovindou) ont exprimé des réticences initiales, notamment par manque de compréhension des objectifs du projet. Une sensibilisation adaptée a permis de les convaincre d'y participer.
Quel rôle joue la connaissance traditionnelle des habitants ?
Elle est essentielle pour retracer l'histoire du territoire, localiser les sites d’intérêt communautaire et mieux comprendre les dynamiques locales.
Les femmes ont-elles été impliquées dans ce projet ?
Oui, elles ont participé activement aux focus groups et à la prise des points GPS. Pour garantir leur pleine implication, les équipes de terrain ont mis en place des stratégies permettant aux femmes de s'exprimer librement.
Quels sont les principaux bénéfices attendus pour les communautés locales ?
En premier lieu, de mieux connaître et protéger leur territoire. Ensuite, de disposer d'un document officiel justifiant leurs droits ancestraux. Cela permet aussi de réduire les conflits d’usage avec les parties prenantes extérieures, et enfin d’améliorer la cohabitation entre les activités humaines et la conservation de la faune.
Comment cette initiative contribue-t-elle à une meilleure gestion du Parc National de Conkouati-Douli ?
Du côté des communautés, les cartes seront des outils stratégiques pour organiser l’élaboration des plans de développement locaux des villages et pour améliorer la gestion collective de certains espaces ou ressources. Pour le parc, cela permettra d’aménager le parc avec une connaissance fine et en évitant la superposition d’usages, et notamment dans les décisions sur l’adaptation éventuelle du zonage du Parc National. Cela pourra aussi faciliter le règlement des conflits fonciers.

Mapping the future: how participatory mapping empowers communities in Conkouati-Douli National Park
Understanding land use is essential for both conservation and contributing to the development of local communities. In the Conkouati-Douli National Park, a participatory mapping project allows local populations to delimit their territories, document their ancestral rights and contribute to better management of the park. This in-depth work is an essential prerequisite for supporting communities in the future elaboration of their local development and land use plan, a key tool to encourage villages to be actors in their own development. Led by the park's management unit, this participatory mapping initiative spans 31 villages and combines traditional knowledge, modern mapping tools and community collaboration.
By actively involving the inhabitants, the project aims to improve conflict resolution, strengthen conservation and ensure that those who have lived on these lands for generations have a say in their future.
In this interview, we explore how participatory mapping works, its importance and its impact on the conservation of one of the richest ecosystems in Central Africa.
Alice Paghera-Messager,ecotourism & marketing manager, Ninelle Batchi, community facilitator on environmental awareness and education, & Stevy Endurance Nkellankela, mapping-technology manager


Can you briefly introduce the participatory mapping project in Conkouati-Douli National Park?
Participatory mapping is a tool that allows local communities to represent their traditional living spaces on a map. This approach helps improve understanding of village land use and recognizes the customary rights of residents. Initiated by the Management Unit of Conkouati-Douli National Park, this project involves 31 villages and runs from June 2023 to December 2024. Participatory mapping is a powerful tool for sustainable land management. By involving local communities, it promotes both environmental conservation and respect for customary rights. This collaborative approach paves the way for better coexistence between communities and the biodiversity of Conkouati-Douli National Park.
What are the main objectives of this project?
The objectives are multiple. First, to develop a precise cartographic database on village forest use. Second, to contribute to a better understanding of human-wildlife conflict around the Park, as well as the frequency and location of these conflicts. Furthermore, the tool provides communities with a physical document (a map) justifying their territory or area of action while representing their ancestral rights. It also ensures that communities have the necessary skills and knowledge to understand the challenges of the approach and to produce their own maps as part of the development of their local development plan.
Finally, it helps the various stakeholders (National Park and local communities) understand the use of village land, encourage forest and wildlife conservation by involving communities, and guide decisions in the revision of the Park's management plan.
Why is it essential to involve local communities?
Communities are the traditional users and first custodians of these lands. Their participation is crucial as they possess in-depth knowledge of traditional use areas, sacred sites, and wildlife habitats. This collaboration also helps identify hidden issues such as social inequalities or land-use conflicts.
How does a participatory mapping session take place?
The process consists of several stages:
Awareness-raising: communities are informed about the participatory mapping process, and their informed consent is obtained through the signing of an agreement;
Socio-economic data collection: focus groups are organized with different social groups (indigenous people, men, women) to gather information on village characteristics, socio-economic situations, natural resource management, and perceptions of human-wildlife conflicts;
Ground mapping: after collecting socio-economic data, communities create a physical representation of their land using an interactive model, facilitated by the community development team. This is later reproduced on paper;
GPS data collection and map development: the community receives training on GPS use and accompanies the team in the field to collect coordinates of different mapped elements. This "ground-truthing" phase helps geo-reference community land-use sites.
Map validation and presentation: the maps are validated through community consultations, ensuring accuracy. The team ensures that the communities can read and interpret their maps, providing additional training if needed. This final stage is critical, as it officially provides the community with a documented map of their land.
What information is included in the final map?
The final maps include geographical data (GPS coordinates of identified areas), as well as socio-economic and historical information about the villages. They are created using Geographic Information System (GIS) software.
How did the communities react to this project?
Most villages welcomed the project enthusiastically. However, some communities (Mpella, Tandou-Goma, Nzambi, Cotovindou) initially expressed reluctance due to a lack of understanding of the project’s objectives. Targeted awareness-raising efforts helped to convince them to participate.
What role does traditional knowledge play in this project?
Traditional knowledge is essential for retracing the history of the land, identifying community heritage sites, and understanding local dynamics.
Were women involved in this project?
Yes, women actively participated in focus groups and GPS data collection. To ensure their full involvement, the field teams implemented strategies to allow them to express themselves freely.
What are the main expected benefits for local communities?
First, to better understand and protect their territory. Second, to have an official document justifying their ancestral rights. This also helps reduce conflicts of use with external stakeholders, and finally, improves coexistence between human activities and wildlife conservation.
How does this initiative contribute to better management of Conkouati-Douli National Park?
For the communities, the maps will be strategic tools for organizing the development of local development plans for villages and for improving the collective management of certain spaces or resources. For the park, this will allow for the development of the park with detailed knowledge and avoiding overlapping uses, particularly in decisions on the possible adaptation of the zoning of the National Park. This could also facilitate the resolution of land disputes.