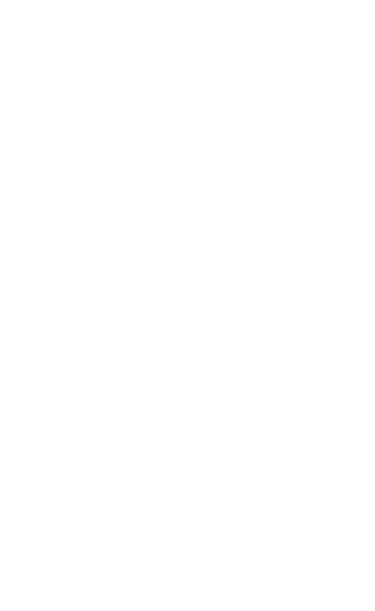Des barrières électriques dans le Parc National de Conkouati-Douli pour apaiser les tensions entre les éléphants et les communautés
Dans les villages bordant le Parc National de Conkouati-Douli (PNCD), les éléphants ravagent régulièrement les cultures vivrières, aggravant l’insécurité alimentaire et sapant les efforts de conservation. Pour répondre à ces défis, des barrières électriques sont progressivement installées autour des périmètres agricoles. Dans cette interview, le responsable du département de développement communautaire en charge du projet nous explique les enjeux, les résultats observés et la participation des communautés locales. Un grand merci à Ollivier Girard, photographe du projet NaturAfrica, dont les magnifiques images accompagnent et enrichissent cet article.
English version below


Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement général d'une barrière électrique et pourquoi elles sont aujourd’hui une priorité dans le cadre du développement communautaire autour du parc ?
Les barrières électriques fonctionnent grâce à un dispositif composé d’un panneau solaire, d’une batterie et d’un électrificateur qui envoie des impulsions de plus de 10 000 volts toutes les 30 secondes (1/2 seconde) dans les câbles formant la ligne de défense. Cette barrière est visible à l’œil nu, ce qui en fait déjà un obstacle physique. Elle agit comme répulsif principal pour les éléphants. Elles sont aujourd’hui prioritaires dans le développement communautaire en raison de l’augmentation marquée des conflits liés à la destruction des cultures par les éléphants dans presque tous les villages du PNCD. En l’absence d’un système de compensation fonctionnel, ces pertes agricoles accroissent le risque d’insécurité alimentaire. La construction de barrières permettra donc de sécuriser les périmètres agricoles et d’assurer l’approvisionnement local en produits vivriers.
Quelle est l’ampleur actuelle des conflits homme-éléphant dans les villages périphériques du parc ? Quelles sont les principales conséquences pour les communautés et les éléphants ?
Depuis une dizaine d’années, les villages du PNCD partagent leur zone agricole avec les éléphants. Les conflits se sont intensifiés depuis 2018 et continuent de croître. Aujourd’hui, 80 % des villages signalent la destruction de cultures. Cette situation entraîne une pénurie de manioc, une dépendance accrue vis-à-vis de l’approvisionnement de Pointe-Noire, et une hausse du coût de la vie. De plus, de nombreuses familles abandonnent l’agriculture pour se tourner vers la chasse et la pêche, augmentant ainsi la pression sur les ressources naturelles du parc. Chez les éléphants, la principale conséquence est le risque accru de braconnage. Dans certaines zones, les pièges artisanaux utilisés par les villageois (colliers métalliques) peuvent les blesser, voire les tuer
Quels sont les objectifs principaux de l’installation de ces barrières ?
Nous visons la sécurité alimentaire des communautés et une meilleure coexistence entre humains et éléphants. L’objectif est de rendre les zones cultivées inaccessibles aux éléphants, en espérant qu’ils quittent les zones communautaires faute de nourriture à portée
Quelles typologies de barrières électriques avez-vous mises en œuvre ou envisagez-vous ?
Nous avons expérimenté deux types de barrières : la barrière de type kényan et celle de type gabonais. La barrière kényane, plus complexe et coûteuse, nécessite davantage de matériel et de compétences. Elle offre une bonne protection grâce à des "tentacules" qui empêchent les éléphants de la toucher. En revanche, la barrière gabonaise est plus simple à installer et plus abordable (environ 2 000 000 FCFA pour 5 à 10 hectares, soit 200 à 400 000 FCFA par hectare). Elle se compose d’un ou deux câbles. Dans les deux cas, le principe de fonctionnement reste identique, et les deux présentent une certaine fragilité en cas de détérioration.
Dans quels villages ces types de barrières sont-ils déjà installés ou en cours d’installation ?
À ce jour, une barrière de type kényan est opérationnelle à Mvandji, et une de type gabonais à Nzambi centre. Quatre autres sont en construction à Koutou, Tchilounga, Konongo et KM4. Dix autres villages seront prochainement identifiés.
Comment les communautés locales sont-elles impliquées dans le processus ?
Les communautés concernées participent activement. Nous les invitons à se regrouper autour d’un même périmètre qu’elles se partagent ensuite équitablement. Elles choisissent le site, organisent la répartition des parcelles et assurent l’entretien des abords. Elles prennent aussi part aux travaux préparatoires et à l’installation. Des comités de gestion sont en cours de mise en place pour assurer le suivi et la maintenance, après avoir reçu des formations spécifique
Une formation ou un accompagnement sont-ils proposés aux villageois ?
Oui. Les formations couvrent non seulement l’entretien et la maintenance des barrières, mais aussi les bonnes pratiques agricoles pour optimiser l’usage durable de ces périmètres protégés.
Quels sont les défis logistiques ou techniques rencontrés ?
Le principal défi est logistique : le matériel est acheté en Afrique du Sud. Lors de l’installation, certains villagois ne prennent pas bien soin des périmètres qui leur sont attribués. Heureusement, nous avons désormais les compétences nécessaires pour réaliser nous-mêmes les installations, ce qui facilite grandement notre travail sur le terrain.
Quels premiers retours avez-vous obtenus dans les villages déjà équipés ?
Dans les zones protégées, les communautés ont pu récolter sans perte liée aux éléphants. Les témoignages sont très positifs quant à l’efficacité de ces barrières.
Comment évaluez-vous l’efficacité de ces solutions ?
Les barrières électriques ne suffisent pas à éliminer tous les conflits homme-faune, mais elles permettent d’apaiser les tensions et de favoriser une meilleure collaboration entre les communautés et les gestionnaires du PNCD.
@ 2025-UE/NaturAfrica Afrique centrale/Ollivier Girard

Electric fences in Conkouati-Douli National Parc to ease tensions between elephants and communities
In the villages surrounding Conkouati-Douli National Park (CDNP), elephants regularly destroy food crops, worsening food insecurity and undermining conservation efforts. To address these challenges, electric fences are gradually being installed around agricultural areas. In this interview, the head of the community development department in charge of the project explains the stakes, observed results, and the participation of local communities.
Special thanks to Ollivier Girard, photographer for the NaturAfrica project, whose stunning images accompany and enrich this interview.
Alice Paghera-Messager, ecotourism & marketing manager & Elistin Koussafoula, head of the community development department


Can you explain how an electric fence works in general, and why these are now a priority in the context of community development around the park?
Electric fences work with a system composed of a solar panel, a battery, and an energizer that sends pulses of over 10,000 volts every 30 seconds (0.5 seconds duration) through wires forming the defense line. The fence is visible to the naked eye, which already acts as a physical deterrent. It mainly serves as a repellent to elephants. They are now a priority in community development due to the marked increase in conflicts related to crop destruction by elephants in nearly all CDNP villages. In the absence of a functional compensation system, these agricultural losses increase the risk of food insecurity. Installing fences therefore helps secure farming areas and ensure a local supply of food crops.
What is the current extent of human-elephant conflict in the park’s peripheral villages? What are the main consequences for communities and elephants?
For about a decade, villages located in the eco-development area of the National Park have shared agricultural zones with elephants. Conflicts have intensified since 2018 and continue to grow. Today, 80% of the villages report crop destruction. This leads to cassava shortages, increased dependency on supplies from Pointe-Noire, and a rising cost of living. Many families are abandoning farming and turning to hunting and fishing, which increases pressure on the park’s natural resources. For elephants, the main consequence is a heightened risk of poaching. In some areas, artisanal traps used by villagers (metal collars) can injure or even kill them
What are the main goals of installing these fences?
We aim to ensure food security for communities and foster better human-elephant coexistence. The goal is to make cultivated areas inaccessible to elephants, in the hope that they leave community zones due to lack of available food
What types of electric fences have you implemented or are planning to implement?
We’ve tested two types: the Kenyan model and the Gabonese model. The Kenyan fence, more complex and expensive, requires more materials and skills. It offers good protection thanks to “tentacles” that prevent elephants from touching it. In contrast, the Gabonese fence is easier to install and more affordable (around 2,000,000 FCFA for 5 to 10 hectares, or 200,000 to 400,000 FCFA per hectare). It uses one or two wires. In both cases, the operating principle remains the same, and both models are somewhat vulnerable to damage
In which villages are these types of fences already installed or being installed?
So far, a Kenyan-style fence is operational in Mvandji, and a Gabonese-style one in Nzambi Centre. Four more are under construction in Koutou, Tchilounga, Konongo, and KM4. Ten additional villages will be identified soon.
How are local communities involved in the process?
The communities actively participate. They are encouraged to group around a shared perimeter, which they then divide fairly among themselves. They choose the site, organize plot distribution, and maintain the surroundings. They also participate in preparatory work and installation. Management committees are being set up to oversee monitoring and maintenance after receiving specific training
Is training or support provided to the villagers?
Yes. Training covers not only fence maintenance and upkeep, but also good agricultural practices to optimize the sustainable use of these protected areas
What logistical or technical challenges have you encountered?
The main challenge is logistics: equipment is purchased in South Africa. During installation, some villagers don’t take proper care of the perimeters assigned to them. Fortunately, we now have the necessary skills to carry out installations ourselves, which greatly facilitates fieldwork
What initial feedback have you received from the villages already equipped?
In protected zones, communities have been able to harvest crops without losses from elephants. Feedback is very positive regarding the effectiveness of the fences
How do you assess the effectiveness of these solutions?
Electric fences alone do not eliminate all human-wildlife conflicts, but they help reduce tensions and foster better collaboration between communities and the National Park’s managers.
@ 2025-UE/NaturAfrica Afrique centrale/Ollivier Girard